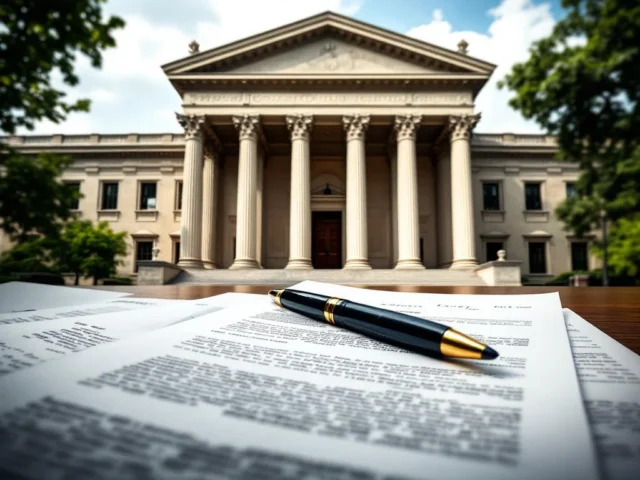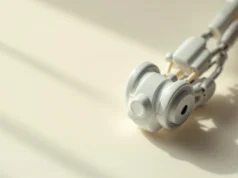Les failles dans la prise en charge des AVC alertent la Cour des comptes
Chaque année en France, 120 000 personnes souffrent d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Parmi elles, 30 000 décèdent. Dans un rapport publié le mardi 28 octobre, la Cour des comptes tire la sonnette d’alarme sur plusieurs lacunes dans la gestion médicale de ces urgences vitales.
Le rapport souligne d’abord un déficit en prévention. Celle-ci n’est pas suffisamment priorisée ni organisée autour d’une politique claire. La prévention de l’AVC est liée à celle des maladies cardiovasculaires, partageant des facteurs de risque communs tels que le tabac, l’alcool, une mauvaise alimentation, la sédentarité, ainsi que des facteurs métaboliques comme l’hypertension, le diabète ou le cholestérol.
Des facteurs de risque mal connus
Si l’hypertension demeure le principal facteur de risque, sa détection et sa prise en charge stagnent, voire régressent chez les femmes. La Cour des comptes indique que la lutte contre l’hypertension devrait être une priorité nationale.
Par ailleurs, certains facteurs encore peu connus ou peu pris en compte dans la société augmentent le risque d’AVC, comme l’apnée du sommeil, la consommation de drogues ou la combinaison de la contraception chimique et du tabac chez les jeunes femmes.
Les personnes âgées de plus de 60 ans, celles ayant des comorbidités ou ayant déjà subi un accident ischémique transitoire sont particulièrement vulnérables. Pourtant, la prévention est insuffisante, notamment en matière de dépistage et de suivi de ces populations. La Cour recommande la mise en place d’une stratégie nationale de communication pour mieux faire connaître l’AVC à la population.
Une offre de soins insuffisante
Un plan lancé en 2010 visait à créer 140 unités neuro-vasculaires (UNV) pour traiter en urgence les patients victimes d’un AVC. Si cet objectif a été atteint, le nombre d’unités reste inférieur aux besoins actuels, et leur répartition est inégale sur le territoire.
En 2023, seulement la moitié des victimes ont pu bénéficier d’un passage en unité neuro-vasculaire, contre un objectif de 90%. La difficulté de recrutement de professionnels de santé dans ces structures limite leur capacité d’accueil. Certaines unités doivent refuser des patients ou fermer des lits.
Une victime d’AVC raconte avoir attendu plusieurs heures avant d’être prise en charge dans une UNV. Lors d’un AVC, deux millions de neurones meurent chaque minute, ce qui rend ces délais critiques.
Un accompagnement post-AVC à améliorer
Le suivi des patients après un AVC est également déficient. En 2022, 17 000 personnes parmi les 75 000 touchées ont quitté l’hôpital avec des handicaps lourds sans avoir pu bénéficier de soins de réadaptation, faute d’accès à ces services.
La Cour souligne que la reprise d’une activité professionnelle est souvent difficile après un AVC. Près de 10 % des victimes âgées de 40 à 59 ans sont en situation d’invalidité.
De plus, environ 20 000 victimes bénéficient d’une longue maladie sans avoir de médecin traitant. Cette absence de suivi médical complique la prévention de nouvelles récidives et l’adoption de comportements plus sains.
Le rapport insiste sur l’importance d’une prise en charge adaptée, dès l’hospitalisation et lors des soins de rééducation. Pourtant, près d’un tiers des victimes d’AVC hémorragiques avec de lourds handicaps ne sont pas hospitalisées en unité neuro-vasculaire.
La Cour des comptes estime qu’une meilleure organisation, une coordination renforcée entre acteurs de santé et une réduction des durées de séjour pourraient permettre d’économiser environ 200 millions d’euros.